Crise sino‑japonaise actuelle
Le 7 novembre 2025, la nouvelle cheffe du gouvernement japonais a lié pour la première fois la sécurité de l’archipel à celle de Taïwan : lors d’une audition au Parlement, elle a estimé qu’une attaque ou un blocus chinois contre l’île constituerait une « situation menaçant la survie du Japon » et pourrait justifier le recours à la force en vertu de la loi de 2015 sur la défense collective. Elle a refusé de retirer ses propos malgré les critiques, affirmant qu’ils restaient conformes à la ligne gouvernementale. Jusque‑là, Tokyo cultivait une « ambiguïté stratégique » et névoquait pas publiquement de réplique militaire à une crise autour de Taïwan.
Ces déclarations ont provoqué un tollé à Pékin. Le consul général de Chine à Osaka a publié un message insultant supprimé depuis; les ministères chinois des affaires étrangères et de la défense ont convoqué l’ambassadeur japonais et exigé une rétractation. La porteée symbolique des propos n’a pas échappé à Beijing : pour les dirigeants chinois, l’île est une province « inaliénable » et toute intervention étrangère franchirait une ligne rouge. Un porte‑parole de la défense a même averti qu’une intervention japonaise subirait une « défaite écrasante ».
Réactions croisées et surenchère
Le climat diplomatique s’est rapidement dégradé. Pékin a convoqué l’ambassadeur japonais puis, dans une logique de riposte, Tokyo a rappelé le représentant chinois pour protester contre les menaces du consul d’Osaka. Les échanges de notes verbales se sont doublés de mesures concrètes : la Chine a déconseillé à ses ressortissants de voyager au Japon en raison de « risques importants », a invité ses étudiants à être vigilants et a autorisé ses compagnies aériennes à rembourser sans frais les billets pour le Japon. Ce message a suscé l’indignation de Tokyo, qui y a vu une réponse disproportionnée et contraire à l’objectif d’une relation « mutuellement avantageuse ». L’ambassade du Japon à Pékin a parallèlement conseillé à ses compatriotes de faire preuve de prudence, de se déplacer en groupe et d’éviter les lieux très fréquentés.
Sur le plan militaire, la Chine a accentué la pression. Ses garde‑côtes ont mené le 16 novembre une patrouille dite de « protection des droits » autour des îles de la mer de Chine orientale administrées par le Japon (Senkaku pour Tokyo, Diaoyu pour Beijing). Cette manoeuvre s’est accompagnée de survols de drones près de Yonaguni et du passage de dizaines d’avions et de navires militaires autour de Taïwan, intensifiant la campagne de pression chinoise. Les incursions de navires chinois dans ces eaux disputées sont devenues plus longues et plus fréquentes ces dernières années.
Ces gestes ont ravivé un contentieux territorial ancien. Les îles Senkaku/Diaoyu, situées sur des voies maritimes stratégiques et supposées riches en ressources, sont administrées par le Japon mais revendiquées par la Chine. Les deux pays s’y opposent régulièrement depuis des décennies, et Tokyo dénonce les patrouilles chinoises comme des violations de sa souveraineté. Les visites de responsables japonais au sanctuaire Yasukuni et les différends sur l’héritage de la guerre renforcent en outre la méfiance émotionnelle entre les deux nations.
Coûts économiques et recherche d’apaisement
Au‑delà des paroles et des navires, la crise commence à peser sur les échanges. La Chine constitue la première source de touristes pour le Japon : 7,5 millions de visiteurs chinois se sont rendus dans l’archipel entre janvier et septembre 2025, soit un quart des arrivées étrangères, et ils ont dépensé plus de 3 milliards d’euros au troisième trimestre. L’appel de Beijing à s’abstenir de voyager a fait chuter en Bourse les entreprises liées au tourisme : le fabricant de cosétiques Shiseido a perdu plus de 9 %, les grands magasins Mitsukoshi et Takashimaya entre 6 et 11 %, et le groupe de distribution Pan Pacific a cédé jusqu’à 9,7 %. Les compagnies aériennes japonaises ont aussi reculé, malgré l’absence d’annulations massives.
La dimension économique est d’autant plus sensible que la Chine et le Japon restent étroitement interdépendants. Ils échangent chaque année pour des centaines de milliards de dollars et les entreprises japonaises sont très présentes sur le marché chinois. Les autorités des deux pays cherchent donc à limiter les dégâts : Tokyo a dépêché à Pékin un haut diplomate chargé de l’Asie‑Pacifique pour tenter de renouer le dialogue, tandis que les ministres des affaires étrangères se sont dits ouverts à une rencontre en marge d’un sommet international. Cependant, la Chine a indiqué qu’aucune rencontre bilatérale n’était prévue en marge du G20 en Afrique du Sud.
Implications régionales et perspectives
Cette nouvelle tension intervient dans un contexte où le Japon renforce ses capacités militaires et ses partenariats avec d’autres pays asiatiques face à une Chine plus assertive. La constitution pacifiste, qui limite l’usage de la force aux situations d’autodéfense, a été interprétée depuis 2015 pour autoriser un soutien à un allié si l’existence même du pays est menacée. L’exemple de Taïwan invoqué par la première ministre pose la question de la définition d’une menace existentielle et du rôle de l’alliance américaine dans la région. De nombreux analystes soulignent que tout conflit autour de Taïwan impliquerait rapidement les Etats‑Unis et pourrait embraser toute l’Asie du Nord‑Est.
Pour l’instant, aucun des deux gouvernements ne souhaite une rupture. Le Japon a besoin du marché chinois pour soutenir sa croissance, et la Chine témoigne d’un attachement à la stabilité économique. Mais l’affaire souligne la fragilité d’une relation marquée par des rancœurs historiques et des ambitions stratégiques divergentes. Tant que la question de Taïwan et celle des îles Senkaku/Diaoyu resteront irrésolues, chaque déclaration ou manoeuvre militaire risque de provoquer une nouvelle crise, avec des répercussions bien au‑delà des deux protagonistes.

L'énergie nucléaire dans l'UE et les coûts

Fer et acier: Partenaire commercial de l'UE?
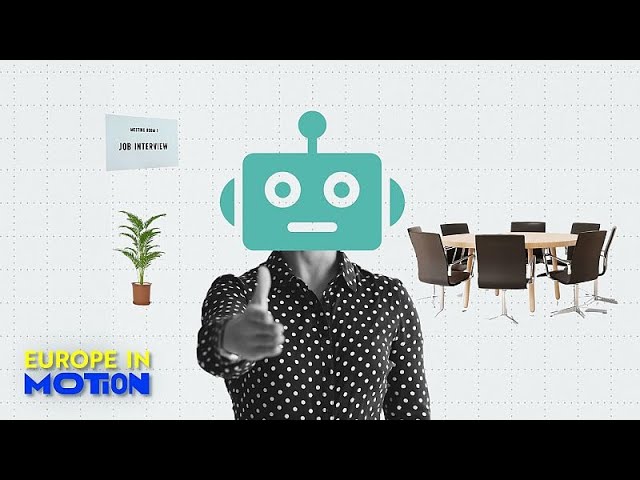
IA aide-t-elle à choisir les candidats?

Europe: Le trafic aérien et le climat
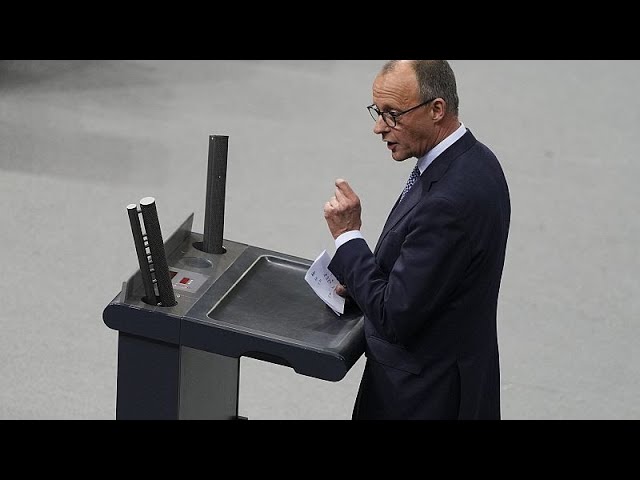
Allemagne: Paquet de réformes sur les migrations

L'antisémitisme gagne du terrain

Commémoration: 80 ans après Auschwitz

Donald J. Trump: L'Amérique est de retour

Meta et les services numériques?

Klaus Welle: L'Europe en transition
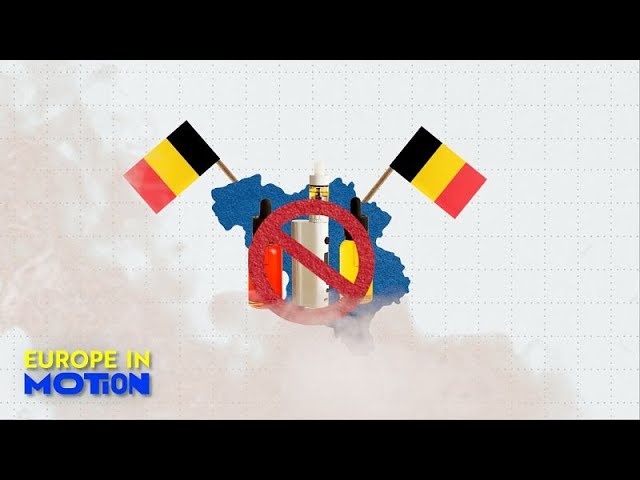
UE: Réglementation tabac - vapotage?


 Paris
Paris

 Lyon
Lyon
 Lille
Lille
 Monaco
Monaco
 Bordeaux
Bordeaux
 Luxembourg
Luxembourg
 Marseille
Marseille
 Brussels
Brussels
 Guernsey
Guernsey
 Jersey
Jersey
 Burkina Faso
Burkina Faso
 Guinea
Guinea
 Mali
Mali


